Qu'est-ce que le SDAGE ?

Besoin de transférer le contrat d'eau ?
Notre service global s'occupe du transfert de l'ensemble de vos contrats (électricité, gaz, eau, assurances, télécom, etc.).
09 87 67 54 96Annonce - Service Selectra indépendant de tout fournisseur d'eau
Notre plateforme téléphonique eau.selectra est actuellement fermée
Un conseiller Selectra vous rappelle dès que possible :
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est le plan d'action majeur de la politique de l'eau en France : tous les six ans, il fixe les grandes lignes pour gérer, protéger et restaurer nos rivières, nappes et milieux aquatiques. Adopté à l’échelle du bassin hydrographique, il traduit sur le terrain les ambitions nationales et européennes fixées par la DCE (Directive Cadre sur l'Eau).
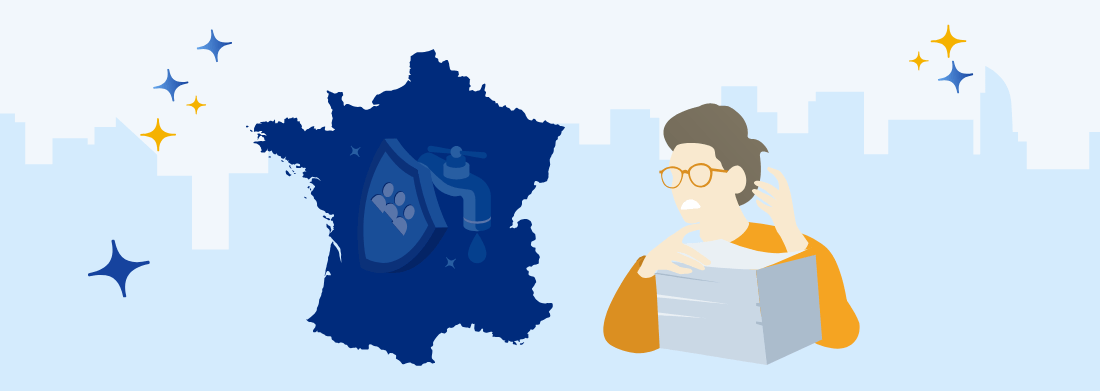
Qu’est-ce que le SDAGE ?
Le SDAGE, ou schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, est un programme permettant d'encadrer la gestion de l'eau en France. Il est élaboré pour chaque grand bassin hydrographique et il fixe les grandes orientations à suivre pendant six ans pour préserver la ressource en eau et améliorer sa qualité.
Le SDAGE influence de nombreuses décisions locales : il sert de référence aux collectivités pour leurs projets liés à l'eau potable, d'assainissement ou de protection des milieux aquatiques. Par exemple, lorsqu'une commune modernise son réseau d'eau ou rénove une station d'épuration, les actions doivent être cohérentes et ne doivent pas enfreindre les objectifs du SDAGE.
Pour l'usager, cela se traduit par des services d'eau plus performants et durables, une meilleure qualité de l'eau potable, et une préservation renforcée des ressources locales (rivières, nappes souterraines, zones humides). En somme, le SDAGE vise à garantir à chacun une eau plus sûre, disponible et respectueuse de l'environnement.
Quels sont les objectifs du SDAGE ?
Chaque SDAGE poursuit à la fois des objectifs communs à l'échelle nationale et des objectifs spécifiques à son bassin hydrographique.
Des objectifs communs à tous les SDAGE
Tous les SDAGE doivent respecter le cadre fixé par la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) et par la loi française sur l'eau et les milieux aquatiques. Leur but commun est de :
- Préserver et restaurer la qualité des eaux (rivières, nappes, littoraux) pour atteindre le “bon état écologique” ;
- Assurer un équilibre durable entre les besoins humains et les ressources naturelles ;
- Protéger les populations contre les risques d'inondation et de sécheresse ;
- Promouvoir une gestion solidaire de l'eau entre les territoires et les usages.
Ces objectifs nationaux garantissent une cohérence dans la politique de l'eau sur tout le territoire français.
Des objectifs adaptés à chaque bassin
Chaque bassin hydrographique (Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée, etc.) fait face à des enjeux locaux différents. Par exemple, le bassin Loire-Bretagne se concentre beaucoup sur la pollution agricole (nitrates, pesticides). Le bassin Rhône-Méditerranée quant à lui agit davantage sur la gestion de la ressource en période de sécheresse, et le bassin Seine-Normandie travaille notamment sur la pollution urbaine et industrielle.
C'est pour cela qu'en plus des objectifs communs et nationaux, chaque SDAGE axe ses priorités selon les problématiques locales rencontrées.
Qui élabore et met en œuvre le SDAGE ?
Le SDAGE est élaboré à l'échelle de chaque grand bassin hydrographique par un organisme appelé comité de bassin (CB), souvent surnommé le "Parlement local de l'eau". Ce comité réunit des représentants de l'État, des collectivités locales, des associations de protection de l'environnement, des agriculteurs, des industriels et des usagers de l'eau. Ensemble, ils définissent les grandes priorités pour protéger la ressource et garantir un accès durable à l'eau potable.
Une fois le SDAGE adopté, c'est l'agence de l'eau du bassin concerné qui veille à sa mise en œuvre. Elle finance les projets portés par les communes, syndicats d'eau, agriculteurs ou entreprises : modernisation des réseaux, réduction des fuites, dépollution ou restauration des milieux aquatiques.
Pour l'usager, cela se traduit concrètement par des investissements locaux visant généralement à améliorer la qualité de l'eau, à réduire les pertes en réseau ou encore à renforcer la protection des captages d'eau potable.
Quels sont les enjeux du SDAGE pour les années à venir ?
Principaux enjeux des bassins hydrographiques en France
Bassin Loire-Bretagne
Enjeux du SDAGE 2022-2027 :
- Lutter contre les pollutions diffuses (pesticides, nitrates) ;
- Préserver la ressource face au changement climatique ;
- Améliorer la performance des réseaux et des stations d'épuration.
Ce que ça change pour l'usager :
- Une eau du robinet de meilleure qualité, grâce à la protection renforcée des captages ;
- Des travaux sur les réseaux susceptibles d'entraîner une légère hausse de la facture à court terme, mais une meilleure efficacité et moins de fuites à long terme ;
- Plus de communication sur la consommation d'eau : bilans locaux, sensibilisation et outils de suivi.
Bassin Artois-Picardie
Enjeux du SDAGE 2022-2027 :
- Réduire les pollutions domestiques et industrielles ;
- Restaurer les cours d'eau et zones humides ;
- Garantir une eau potable disponible dans les zones urbaines denses.
Ce que ça change pour l'usager :
- Des investissements dans les stations d'épuration et les réseaux, financés en partie par les redevances des factures d'eau ;
- Une facture qui peut légèrement évoluer, mais pour un service plus fiable et durable ;
- Une meilleure qualité bactériologique et chimique de l'eau distribuée, notamment dans les zones historiquement sensibles (Nord, Pas-de-Calais).
Bassin Rhin-Meuse
Enjeux du SDAGE 2022-2027 :
- Atteindre le bon état écologique des rivières et nappes souterraines ;
- Réduire les pollutions transfrontalières et industrielles ;
- Mieux gérer les captages d'eau potable prioritaires.
Ce que ça change pour l'usager :
- Des contrôles plus stricts sur la qualité de l'eau distribuée et sur les rejets d'assainissement ;
- Une meilleure transparence sur la provenance et la qualité de l'eau potable via les publications locales ;
- Une facture stable à court terme, les efforts étant centrés sur la performance technique et non sur la hausse des tarifs.
Bassin Rhône-Méditerranée-Corse
Enjeux du SDAGE 2022-2027 :
- Faire face à la sécheresse et au stress hydrique croissant ;
- Améliorer la qualité de l'eau dans les zones littorales et touristiques ;
- Préserver les milieux aquatiques et les zones humides.
Ce que ça change pour l'usager :
- Une plus grande vigilance sur les consommations : campagnes de sensibilisation et tarification progressive encouragée dans certaines collectivités ;
- Des restrictions d'eau plus encadrées, mais anticipées grâce à une meilleure planification locale ;
- À moyen terme, une légère augmentation du coût du m³ liée aux investissements pour la sécurisation de la ressource (captages, stockage, recyclage des eaux usées).
Bassin Adour-Garonne
Enjeux du SDAGE 2022-2027 :
- Répondre aux tensions croissantes entre usages agricoles, industriels et domestiques ;
- Lutter contre les pollutions diffuses ;
- Garantir l'accès à une eau potable de qualité sur tout le territoire.
Ce que ça change pour l'usager :
- Une gestion plus concertée de l'eau, qui favorise les économies dans les zones rurales et périurbaines ;
- Des aides locales à la sobriété, notamment pour l'équipement des foyers (mousseurs, compteurs intelligents) ;
- Une eau plus sécurisée malgré les sécheresses estivales, grâce à la diversification des sources d'approvisionnement.
Bassin Seine-Normandie
Enjeux du SDAGE 2022-2027 :
- Améliorer la qualité des cours d'eau et des eaux côtières ;
- Protéger les zones sensibles aux inondations et à la sécheresse ;
- Réduire les pollutions liées à l'urbanisation et aux rejets industriels.
Ce que ça change pour l'usager :
- Des travaux fréquents sur les réseaux dans les zones urbaines (Île-de-France, Normandie) pour limiter les fuites et moderniser les canalisations ;
- Une eau du robinet plus contrôlée, en particulier dans les zones à forte densité ;
- Une légère hausse possible du prix de l'eau, liée à la rénovation des infrastructures et aux nouvelles obligations de performance.
Questions fréquentes sur le SDAGE
Quelle est la différence entre un SDAGE et un SAGE ?
Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil de planification locale de la politique de l'eau, complémentaire du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux).
Alors que le SDAGE fixe les grandes orientations à l'échelle du bassin hydrographique (comme Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie…), le SAGE décline ces orientations à une échelle plus fine : un bassin versant, une nappe souterraine, un estuaire, etc.
En d'autres termes, le SDAGE établit la stratégie générale, tandis que le SAGE précise les règles locales d'application. Par exemple, sur le bassin Loire-Bretagne, il existe un seul SDAGE, mais plusieurs dizaines de SAGE, chacun adapté aux particularités locales : usages agricoles, besoins en eau potable, risques d'inondation, zones humides à préserver, etc.
Les orientations du SAGE sont plus opérationnelles et concrètes que celles du SDAGE. Elles peuvent fixer des objectifs de qualité des eaux, des zones prioritaires d'action, ou encore des mesures réglementaires (interdiction de certains prélèvements, obligations de suivi, etc.). Le SAGE est élaboré par une Commission Locale de l'Eau (CLE), qui réunit les élus, les usagers et les représentants de l'État, garantissant ainsi une gouvernance partagée et adaptée aux réalités locales.
À quelle fréquence le SDAGE est-il révisé ?
Le SDAGE est révisé tous les six ans.
Quels sont les bassins hydrographiques concernés ?
Chaque bassin hydrographique est soumis à son propre SDAGE. Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) est en quelque sorte la traduction française de la DCE (Directive Cadre sur l'Eau) de chaque bassin hydrographique (Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée Corse, Adour-Garonne, Artois-Picardie Rhin-Meuse).
Comment le SDAGE influence-t-il le prix de l’eau ?
Pour atteindre ces objectifs, les Agences de l'eau et les collectivités doivent financer des programmes d'action (travaux, études, surveillance, innovations). Ces investissements sont en partie financés par les redevances prélevées sur la facture d'eau des usagers (via la part “Organismes publics” qui concerne en grande partie les agences de l'eau). Ainsi, plus les exigences du SDAGE sont élevées, plus les programmes de travaux sont importants, et donc plus les coûts de service peuvent augmenter, ce qui influence le prix de l'eau.
Où peut-on consulter le SDAGE de son bassin ?
Les SDAGE sont consultables dans les agences des comités de bassin, sur le site des agences de l'eau, et dans les préfectures concernées.
